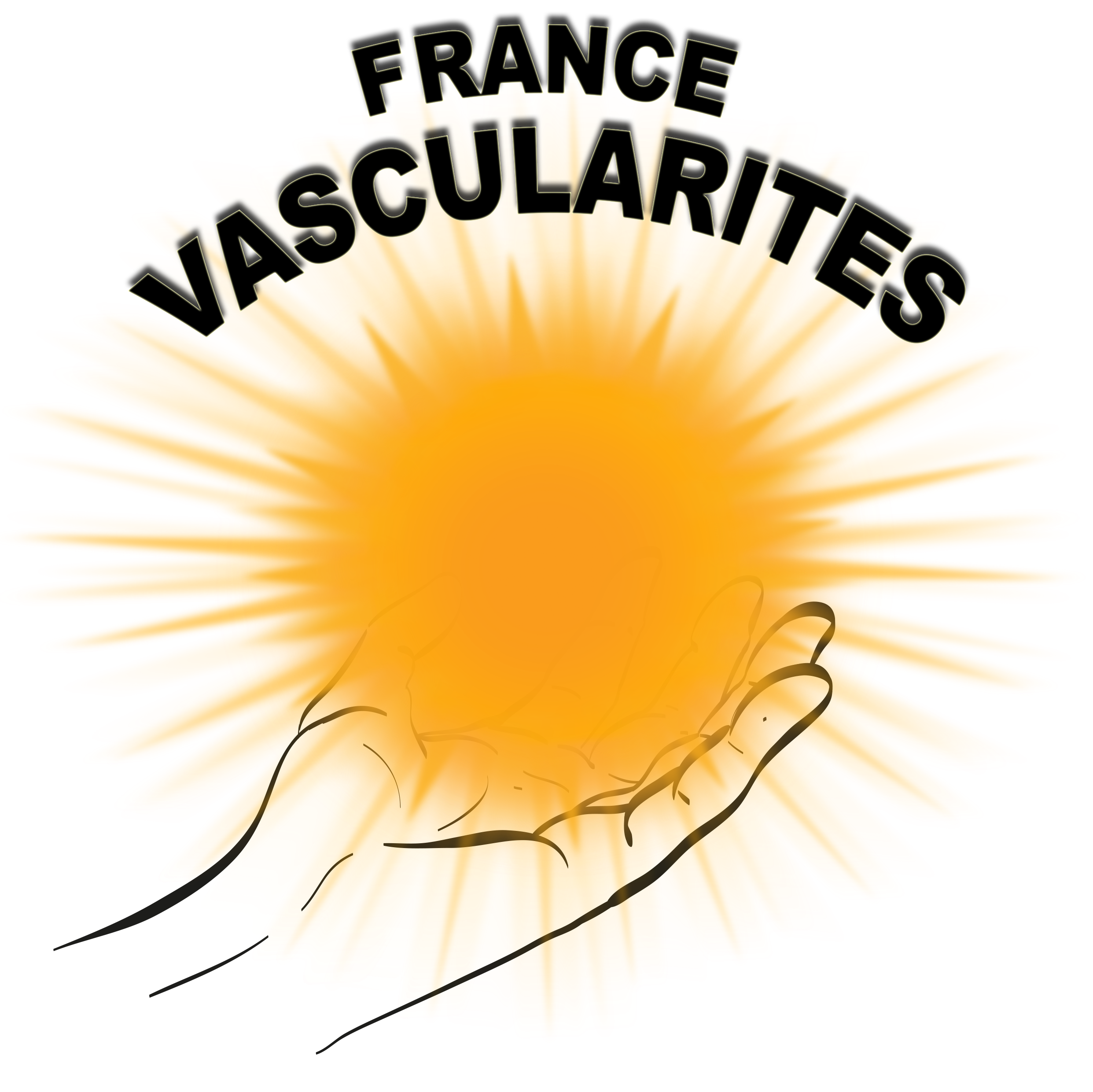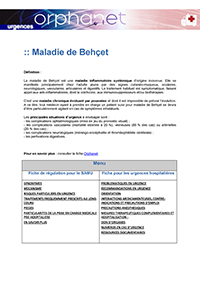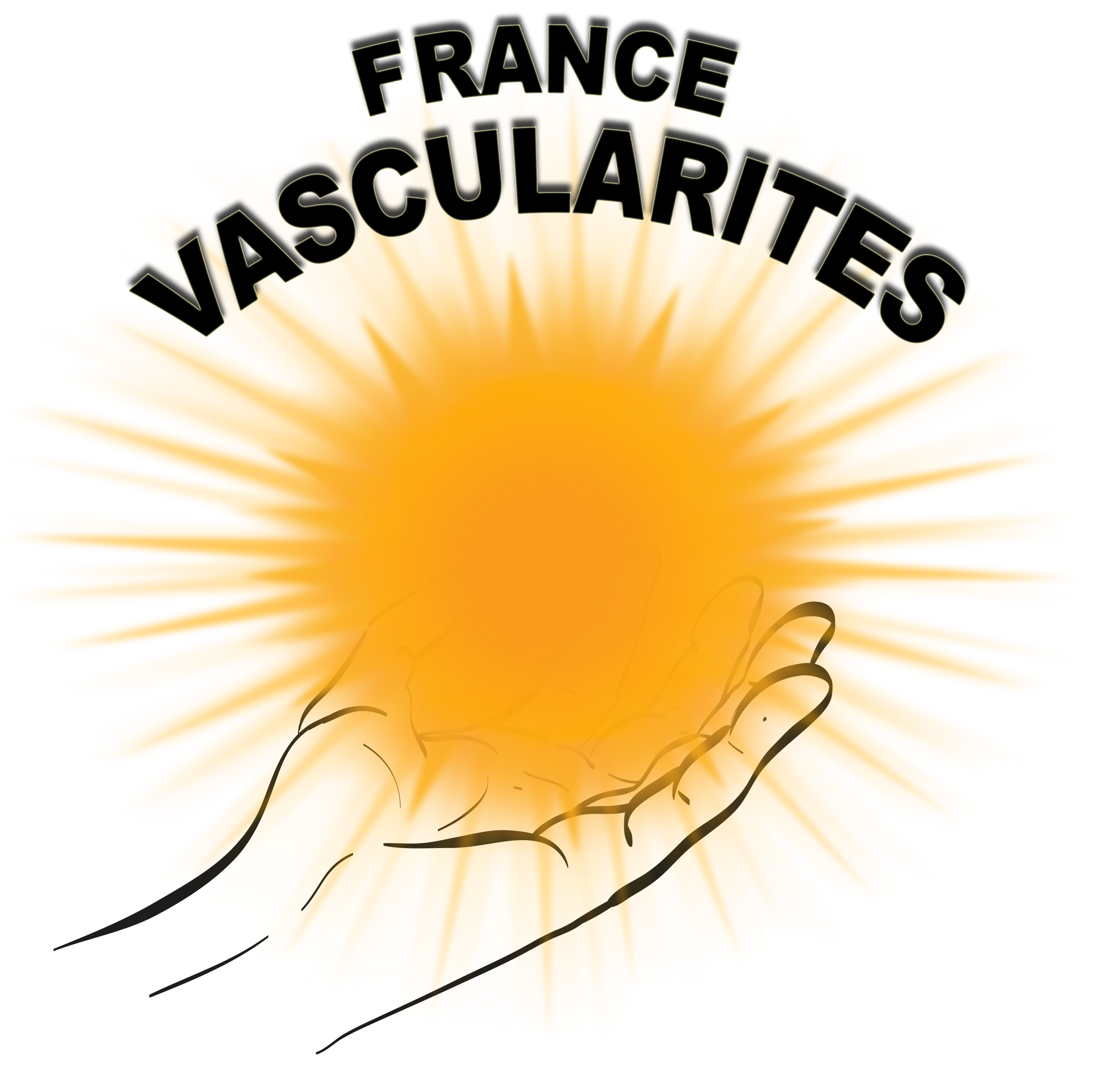+ C'est quoi ? =>
La maladie de Behçet est une maladie caractérisée par une inflammation des vaisseaux sanguins. Elle se manifeste essentiellement par une atteinte des muqueuses, telle des aphtes buccaux ou génitaux, à laquelle s’associe de façon variable une atteinte des yeux, de la peau, des articulations, du système nerveux et plus rarement d’autres organes. Une fatigue très prononcée est également présente. Cette affection, dont la cause est inconnue, est parfois dénommée maladie (ou syndrome) d’Adamantiadès-Behçet, d’après le nom des médecins qui l’ont reconnue et décrite.
Cause
On ne connaît pas la cause exacte de cette maladie. On sait par contre qu’elle n’est pas contagieuse. Il semble exister une prédisposition génétique chez les personnes atteintes, qui expliquerait la sensibilité exagérée de leur système immunitaire à des agents environnementaux ou infectieux, mais ce n’est pas une maladie héréditaire au sens habituel du terme.
Personnes atteintes
La maladie de Behçet touche moins fréquemment les femmes que les hommes, chez qui elle est d’ailleurs souvent plus sévère. Elle est plus fréquente au Moyen-Orient, dans les pays du pourtour méditerranéen et en Asie (route historique des marchands de soie). Au Japon, la maladie de Behçet est la première cause de cécité acquise chez l’adulte.
Symptômes
La majorité des symptômes est liée à une inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite).
Des aphtes buccaux et/ou génitaux ainsi que des lésions de la peau (aphtes cutanés, nodules sous-cutanés ou pustules millimétriques blanches appelées pseudo-folliculites) surviennent par poussées itératives chez plus de 75% des patients.
Une inflammation des yeux peut être constatée au cours de l’évolution de la maladie chez 25–75% des patients (chiffres variables selon les études). Les premiers signes sont des douleurs oculaires, une vision trouble d’un ou des 2 yeux, ou une photophobie (mauvaise tolérance à la lumière avec éblouissement).
Les vaisseaux de petit calibre comme ceux de plus gros calibre peuvent être atteints, ainsi que les vaisseaux du cerveau ou de la moëlle épinière, des jambes (risque de phlébites récidivantes, surtout superficielles), du cœur et/ou des poumons.
Diagnostic
De multiples poussées d’aphtes buccaux (> 3 par an) sont évocatrices de la maladie de Behçet. Mais cela ne suffit pour retenir le diagnostic et d’autres signes cliniques doivent être présents, en particulier au moins 2 des manifestations suivantes : des aphtes génitaux récurrents, une atteinte oculaire, des lésions de la peau et/ou un test pathergique positif (apparition de lésions d’hypersensibilité de la peau après simple piqûre intradermique avec une aiguille fine). Environ 50–70% des patients sont porteurs du gène HLA B51, qui est présent également chez 10–15% des individus totalement sains et indemnes de toute maladie dans la population générale. Il n’existe donc aujourd’hui aucun test totalement spécifique permettant d’affirmer ou de réfuter le diagnostic.
Pronostic
Spontanément, la maladie évolue par poussées, imprévisibles. Les traitements permettent de contrôler les symptômes et de limiter la fréquence de ces poussées. La très grande majorité des patients peuvent ainsi mener une vie quasi normale.
Cependant, des manifestations plus sévères peuvent survenir, parfois même après plusieurs mois ou années depuis le diagnostic de la maladie, en particulier au niveau des yeux ou du système nerveux.
Traitements
On peut soigner les symptômes de la maladie de Behçet et limiter la fréquence des poussées, mais pas la guérir. Le traitement comporte de la colchicine, mais aussi des corticoïdes et/ou des immunosuppresseurs ou immunomodulateurs lorsque cela est nécessaire, par exemple s’il existe une atteinte ophtalmologique ou cérébrale. Parmi les immunosuppresseurs qui sont utilisés, on peut citer le cyclophosphamide, l’azathioprine, les anti-TNF-alpha, l’interféron ou la ciclosporine.
+ Protocole National de Diagnostic et de Soins =>